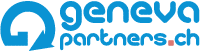– Que raconte «La Fausse suivante»?
– «La Fausse suivante» tient une place particulière dans l’œuvre de Marivaux: elle ne parle pas d’amour! Il n’est question là que d’individualisme, d’argent, d’opportunisme et de manipulations. Lélio convoite une riche comtesse qui lui a prêté une coquette somme afin qu’il puisse acquérir des terres. Ensemble, ils se sont engagés, par l’entremise d’un acte notarié, à payer un dédit conséquent en cas de rupture de la promesse de mariage. Mais entre-temps, Lélio entend parler d’une «demoiselle de Paris», beaucoup plus jeune, extrêmement riche et belle… Pour ne pas avoir à rompre sa promesse avec la comtesse et payer les dix mille livres de dédit, il demande de l’aide à un fringant chevalier afin qu’il la séduise et que ce soit elle qui rompe son engagement. Mais il ignore que le chevalier est en réalité la demoiselle de Paris déguisée en homme. Le conte machiavélique et hilarant peut commencer. Par la grâce du théâtre, Marivaux fait jaillir de nous un rire sain et salutaire. Une légèreté assortie toutefois d’une grande profondeur.
– Quels sont les thèmes abordés dans le spectacle?
– La brutalité des rapports, qu’ils soient de classes ou de sexes, s’exprime tout au long de la pièce. Indépendamment de sa position dans la société, chacun défend sa propre personne au détriment des autres. Ce rapport à l’argent semble questionner très fortement Marivaux à l’époque où il écrit «La Fausse suivante», puisque quelques années auparavant – au moment de la banqueroute de la Banque royale créée par John Law -, il aurait perdu tous ses biens. La question du genre apparaît également: que veut dire être «femme» ou «homme» à cette époque et par extension aujourd’hui? Pour la jeune femme déguisée en chevalier, cette position grisante qui n’a jamais été la sienne ouvre un vaste champ de possibles. Ce n’est donc pas une surprise: si l’on n’y prend garde, l’individualisme et l’opportunisme prônés par une société sont bel et bien les fossoyeurs de l’amour!
– Pourquoi ce texte continue-t-il à nous toucher trois siècles après son écriture?
– Depuis ses débuts, le Théâtre de Carouge a toujours voulu mettre en scène des textes du Répertoire. Je perdure dans cette lignée, car jeter un coup d’œil dans le rétroviseur nous permet de nous inscrire dans l’échelle du temps, nous connecte à notre histoire. Cela nous aide à mieux appréhender le présent et à offrir des perspectives pour l’avenir, probablement avec davantage de sérénité. Les grands auteurs classiques touchent à quelque chose d’universel. Dans le cas de Marivaux, sa capacité d’analyse des comportements humains est impressionnante et nous fait constater que l’être humain n’a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Les mécanismes restent les mêmes… Cependant, un important travail sur le jeu des acteurs est nécessaire pour rendre la langue et le vocabulaire accessibles, puisqu’aucun mot du texte d’origine n’est changé. L’œuvre de Marivaux a une vraie modernité: je ne crée pas des spectacles pour des gens qui sont morts il y a 300 ans! La scénographie et les costumes contribuent à se référer à une époque passée, tout en étant clairement contemporains.
– Marivaux n’offre-t-il donc aucune alternative à ce monde basé sur la cruauté?
– Si, il y a un personnage dans la représentation qui amène de la compassion, ainsi que des moments de divertissement et de grâce. Cela illustre le fait que l’art – dont le théâtre fait partie – n’est pas la cerise sur le gâteau, mais est nécessaire quelle que soit la société dans laquelle nous vivons. C’est un vecteur permettant de nous reconnecter les uns aux autres. Les salles de théâtre réunissent des gens d’univers très différents. L’espace d’une soirée, ils se tolèrent, ils sont émus, ils rient et applaudissent ensemble… ce rôle fédérateur n’est pas anodin dans la société actuelle. Du côté des comédiens, il ne s’agit en aucun cas d’un passe-temps, ni d’un emploi au sens courant du terme, mais d’un véritable partage, l’engagement d’une vie!
Propos recueillis par Véronique Stein