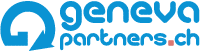Le congrès SWIFCOB, organisé par le Forum Biodiversité Suisse le 8 février 2019, a débouché sur une recommandation forte: pour rendre la population pleinement consciente des enjeux liés à la biodiversité, les experts ne peuvent plus communiquer comme ils l’ont fait jusqu’à présent. Plutôt que de vouloir nous instruire avec des faits, des chiffres et des équations, les scientifiques doivent recourir à d’autres vecteurs. Par le biais de récits vivants, d’images et de productions artistiques en tout genre, ils ne s’adresseront plus seulement à notre cerveau, mais à notre imaginaire. Touchés dans les confins de notre être – avec sa part d’émotions, de valeurs et de représentations -, nous serons encouragés à cohabiter de manière plus harmonieuse avec la biodiversité. Et ce, du pas de nos portes jusqu’au cœur des espaces naturels.
Pour éviter les bugs… branchez-vous sur la toile du vivant!
Les bons gestes face à l’environnement sont donc intrinsèquement liés à notre affect et à nos «croyances». On diminue les pesticides utilisés au jardin. On admire, on s’émerveille, mais on ne touche pas à mains nues un animal sauvage. Non, il ne faut pas écraser les araignées, inutile de chasser les chauves-souris; il est interdit de nourrir un renard ou des pigeons. Ce sont dans ces comportements simples que se jouera notamment la biodiversité de demain. Mais comment faire pour transmettre ces messages, sans tomber dans un discours moralisateur? Julien Perrot, fondateur et rédacteur en chef du magazine «La Salamandre», insiste sur les métaphores et l’esthétique des images comme outils fondamentaux. Le rapport avec le quotidien revêt aussi une grande importance. «La créativité ne devrait se heurter à aucune limite. Le surprenant et l’inédit représentent à cet égard des alliés essentiels», a-t-il souligné lors du colloque SWIFCOB.
L’homme est un conteur
La narration a donc un autre impact que les arguments rationnels. Jusqu’à présent, le thème de la diversité biologique n’a été que peu abordé par les écrivains, philosophes, cinéastes et photographes. Mais le temps presse… Plutôt que d’évoquer toujours les mêmes animaux (marmottes, bébés phoques, loups, etc.), pourquoi ne pas parler d’espèces peu visibles ou inconnues du grand public? Sorties de l’ombre, ces dernières peuvent devenir des «indicateurs bio-culturels». Cela a été le cas au cours des dernières décennies pour les trente espèces nationales de chauves-souris. Ces chiroptères sont en train de devenir des donneurs d’alerte et de puissants porte-parole de la dramatique disparition généralisée des insectes. «La Nuit des chauves-souris», organisée chaque année en Suisse par le CCO et son réseau, est un outil de communication inédit. Aux conférences, excursions, animations, s’ajoutent des films «de chauves-souris». Quant au livre «Very Bat Trip», un abécédaire ludique et artistique, il propose un drôle de voyage au pays de ces petits animaux qui ne font rien comme les autres. L’ouvrage, publié par le Muséum d’histoire naturelle et le CCO en 2018, illustré par 16 élèves de l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI), se lit comme un roman! Plus récemment, le célèbre artiste d’origine chinoise Yan Pei-Ming peint une toile de 24 mètres de long avec des chauves-souris, symboles de la pandémie et victimes d’une fausse accusation. Évoquons également la Gelyella de Monard. Ce minuscule crustacé d’un tiers de millimètre, une fois doté de récits et d’histoires en 2018, est parvenu à s’introduire dans le très sélectif livre des cent grandes icônes de la Suisse (à la place du tunnel du Gothard!). Cette espèce endémique, qui n’existe que dans les Gorges de l’Areuse, fait actuellement l’objet d’une exposition interactive à visiter à la Maison de la Nature neuchâteloise (https://maisonnaturene.ch/la-morille/). En outre, l’histoire de la Gelyella de Monard est interprétée avec talent par la comédienne Joëlle Luthi (Théâtre du Lucernaire à Paris) dans un conte écologique disponible sur «Youtube» . Ces exemples, parmi d’autres, illustrent le pouvoir qu’ont l’art et la culture de changer notre rapport au vivant. Des instruments capables de ramener les hommes aux récits anthropologiques et aux grands mythes fondateurs!
Pascal Moeschler et Véronique Stein
*Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO).